La période était forcément pour moi sur le papier. Comme un aimant, irrésistible. Toujours, et à jamais. Un jour, je comprendrai peut-être pourquoi… Note de …
« Kokoro » de Delphine Roux…
Un tout petit livre certes (128 pages) mais un concentré d’émotions ! Une histoire poétique et émouvante sur deux enfant (Seki et Koichi) qui ont …
« Aime-moi comme tu es » de Cathy Galliègue…
Cela fait beaucoup de bien de se plonger dans un roman qui a le don de vous évader et de vous faire oublier tout le …
« Les promesses » d’Amanda Sthers…
Sandro, Jacques et Louis. Les trois amis de toujours. Laure, Sandra, Bianca, Gilda. Et les autres. Paris. L’Italie. Les promesses. La réalité. Les regrets. « La …
« Un mot sur Irène » de Anne Akrich…
Mon septième livre du challenge des 68 premières fois ! Irène Montès, Professeur à L’Ecole des Hautes en Sciences Sociales, est découverte morte dans un …

« Paris sur l’avenir » de Nathaniel Rich…
New York, dans un futur proche. La vie de Mitchell Zukor mathématicien surdoué mais solitaire va basculer le jour de sa rencontre avec Charnoble, représentant de « FutureWorld », …
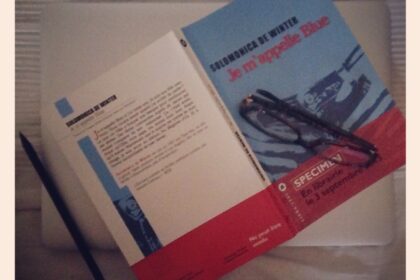
« Je m’appelle Blue » de Solomonica de Winter…
Ce livre est un ovni. Purement et « simplement » ! Mais comment peut-on écrire en étant doué d’une telle maturité dans les prémisses de la fleur …
« Sfumato » de Xavier Durringer…
« Tout ce qui est couvert d’un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu » (Luc, 12:2) Ce livre raconte l’histoire de Raphaël qui …
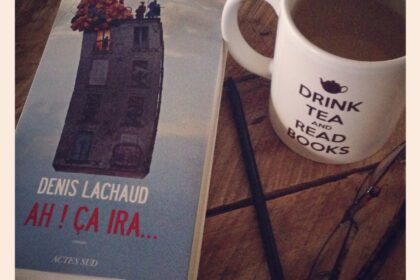
« Ah ! ça ira… » de Denis Lachaud…
Un enlèvement dans les plus hautes sphères de l’Etat français, la mort d’un homme d’affaires new yorkais influent… « Ah ! ça ira… » démarre sur les …